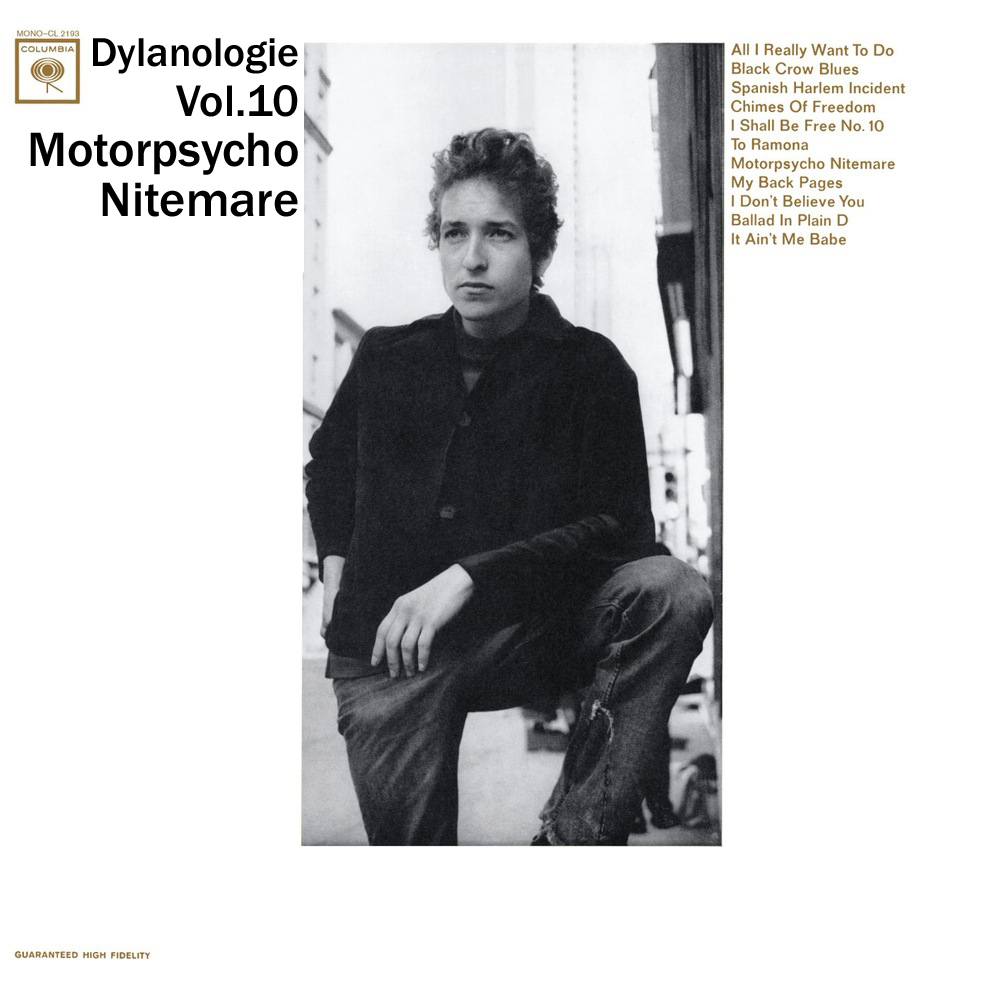Si beaucoup de titres dylaniens comportent le mot « dream », comme nous avons déjà eu par ailleurs l’occasion de le faire remarquer (le sujet de la prochaine interro est parti à la repro), celui-ci est le seul qui fasse référence à un mauvais rêve. Point de créatures malfaisantes, de harpies déchaînées ou de visions fantasmatiques à la Edgar Allan Poe pour autant ici. Chez Dylan, le cauchemar absolu s’incarne dans la figure du redneck, ignorant, prompt à sortir le flingue, naturellement méfiant et viscéralement anti-communiste (même si stricto sensu le terme ne devrait s’appliquer qu’aux individus vaguement en mesure de définir les grands principes du communisme). Dans un registre burlesque, le néo-New-Yorkais tire à boulets rouges (c’est le cas de le dire) sur l’Amérique profonde, fondamentalement conservatrice et patriote, toujours prête à porter au pouvoir tout ce qui ressemble de près ou de loin à un va-t-en-guerre qui jure sur la Bible. On retrouve le Dylan corrosif et désopilant de « Talkin’ World War III Blues », qui s’appuie ici sur une histoire totalement improbable pour saper quelques vérités établies et foncer joyeusement dans le tas.
Où est-t-on au juste ? On l’ignore. Quelque part dans le Midwest sans doute, au beau milieu de ces grandes plaines qui s’étirent sur des milliers de kilomètres. Qui est ce rambler, ce voyageur épuisé qui frappe à la porte d’une ferme ? Nul ne le sait. Il n’est en tout cas probablement pas docteur comme il le prétend (« I’m a clean-cut kid and I been to college too », pas de raison que la bonne société éduquée n’en prenne pas aussi pour son grade tant qu’à faire). Une fois encore, Dylan joue les imposteurs et les faussaires. Le seul nom mentionné est celui de Rita, la fille du fermier, qui ressemble à la fois à Anita Ekberg et Anthony Perkins (forcément, puisqu’elle l’invite à prendre une douche, Psychose, Hitchcock, suivez un peu dans le fond). On est à la frontière du conte bringuezingue, avec le vagabond, le paysan et sa fille en personnages archétypaux, mais les références culturelles et politiques ancrent la narration dans le réel. C’est là que réside la force de percussion de cette chanson, dans cette espèce d’entre-deux qui permet à Dylan d’évoquer des problématiques contemporaines sans avoir l’air d’y toucher et en restant toujours en apparence à un niveau anecdotique.
En quête d’un refuge pour la nuit, l’anti-héros errant se voit d’abord menacé d’une arme, avant que l’autochtone bourru n’accepte de l’accueillir à deux conditions : qu’il ne touche pas à sa fille et traie la vache le lendemain matin. On sent venir le coup fourré… Evidemment, la Rita en question, vamp tout droit sortie d’un film (les stars glamour ont toutes grandi dans des fermes, c’est bien connu), ne manque pas de faire des avances au malheureux jeune homme. Pris au piège, celui-ci s’en sort par une absurde pirouette en clamant son admiration pour Fidel Castro et sa barbe (« I like Fidel Castro and his beard ») avant de s’enfuir à toutes jambes. Il l’a échappé belle, d’autant que son hôte pour le moins agressif possède un arsenal de premier ordre, lui qui n’hésite pas à user d’un exemplaire du Reader’s Digest comme projectile. Aussi désorienté que la cible de cette attaque, on se trouve en territoire inconnu, quelque part entre le slapstick éminemment visuel (imaginer Dylan faire un saut périlleux ne manque pas de saveur), le vaudeville et la satire, et on se demande sérieusement où on a mis les pieds.
Comment ne pas reconnaître Dylan lui-même dans ce personnage qui, cerné par les mauvaises intentions en tous genres, trouve dans la provocation une issue de secours ? Quand l’atmosphère devient étouffante, on peut toujours balancer un bon gros pavé dans la mare et ainsi passer entre les gouttes (vous suivez toujours?) : précisément la stratégie que le Dylan new look adoptera publiquement dès 1965, notamment lors de ses fameuses conférences de presse. Harcelé par des questions moins pertinentes les unes que les autres, il prendra systématiquement la tangente, ne lâchant aux journalistes que des déclarations ininterprétables, volontairement acerbes ou faussement modestes (« I’m only a song and dance man », ben voyons). Si cette chanson se moque ouvertement de l’Amérique paumée façon Fantasia chez les ploucs, elle assène également quelques crochets bien sentis à la face du conformisme bon teint représenté par le Reader’s Digest (les ennemis sont partout, alors autant sauter par la fenêtre). Le journaliste de Time Magazine qui se fait littéralement dézinguer par Dylan dans l’une des scènes marquantes de Don’t Look Back aura l’occasion de se rendre compte que l’homme à l’harmonica ne réserve pas sa morgue aux péquenots de l’Iowa.
Les paroles en intégralité : http://www.bobdylan.com/us/songs/motorpsycho-nightmare
Vidéo :
“Motorpsycho Nitemare”