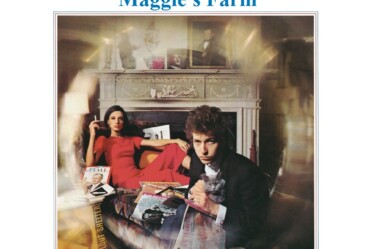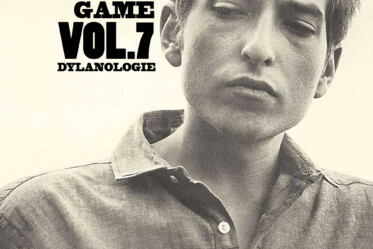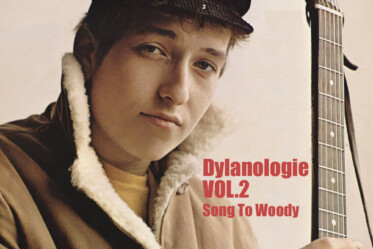D.A. Pennebaker
Objet filmique hybride et novateur à bien des égards, Don’t Look Back, qui retrace la tournée de Bob Dylan au Royaume-Uni en 1965, est à l’image du personnage sur lequel D.A. Pennebaker braque sa caméra: difficilement réductible aux étiquettes et aux appellations. Ni portrait, ni documentaire classique avec voix off et témoignages à l’appui, ni recueil d’anecdotes backstage plus ou moins sulfureuses, le film propose une plongée dans l’intimité d’un artiste en pleine ébullition créatrice et en pleine mutation, qui porte en lui les germes d’une révolution musicale imminente. 1965, année charnière. Confronté pour la première fois aux attentes d’un public britannique venu en masse recevoir la bonne parole et précédé d’une aura quasi-prophétique, Dylan est là et ailleurs, à la fois intensément présent et tendu vers l’avenir, d’ores et déjà décidé à quitter ses oripeaux folk et tourner le dos aux foules qui l’acclament. Don’t look back: mot d’ordre paradoxal d’un musicien qui n’a cessé de se réinventer en revenant toujours aux sources et aux origines.
Collé aux bottines de Dylan, Pennebaker s’efforce de suivre le rythme effréné d’une tournée aussi historique qu’épuisante, et, partisan radical d’une forme d’esthétique de la discontinuité, donne à voir une série de tableaux qui sont autant de facettes du chanteur. Face à une presse curieuse de sonder le phénomène, c’est la persona publique de Dylan qui occupe le devant de la scène, alter ego mythomane à l’ironie mordante, qui élude les questions à grand renfort de faux aphorismes, de slogans à l’emporte-pièce et de nonsense messianique. Fuyant et insaisissable, je-m’en foutiste de façade, il ne livre le fond de sa pensée que lorsqu’on met en doute la sincérité de sa démarche, comme l’apprend à ses dépens ce journaliste de Time Magazine, incarnation de tous les Mister Jones de la terre, dézingué par la rhétorique impitoyable d’un Dylan aussi outré qu’arrogant. Le maître du jeu, celui qui fixe les règles et délimite les frontières du factice, c’est lui et lui seul. Et qu’on ne s’avise guère de le provoquer en duel sur son propre terrain, car à la fin de l’interview, il touche.
Survolté et fiévreux, la clope toujours au coin de la bouche et la jambe gigotante, il noircit des pages et des pages dans sa chambre d’hôtel pendant que Joan Baez fredonne quelque doucereuse mélopée dans son dos. Penché sur sa machine à écrire, l’urgence chevillée au corps, il évoque le stakhanovisme beat de Kerouac. Rien ne compte plus que la prochaine chanson, le prochain vers, le prochain mot. Don’t look back. En montrant Dylan au travail, le film réduit en poussière le mythe du poète fulgurant soudainement saisi par une inspiration venue d’ailleurs et qui n’aurait qu’à coucher sur le papier l’immédiateté de ses visions intérieures. Génial, le bonhomme l’est à la sueur de son front, et il accouche dans la douleur de chansons qui ne se font évidentes qu’a posteriori et une fois achevées. Qui, répète-t-il à qui veut l’entendre, flottaient dans l’air, et qu’il suffisait juste de choper au vol. Balivernes. Dylan apparaît comme un artisan du verbe, un perfectionniste, un monomaniaque de la rime, qui ne sert le sourire en coin« It’s all over now, baby blue » à un auditoire médusé que parce qu’il est tout à fait sûr de son effet et trop content de renvoyer Donovan (c’est qui ce type?) à ses chères études.
Sur scène, Dylan donne presque l’impression d’expédier les affaires courantes lorsqu’il entonne les protest songs à succès que les spectateurs attendent et qui semblent avoir été écrites par une version antérieure de lui-même. Dans le cadre somptueux du Royal Albert Hall, c’est presque mécaniquement qu’il débite le pourtant poignant et implacable réquisitoire chanté qu’est « The Lonesome Death of Hattie Carroll » ou qu’il déroule le fil des couplets prémonitoires de « The Times They Are A-Changin’ ». Sur « It’s Alright, Ma » et « Gates of Eden », l’oeil se fait à nouveau noir et la moue vengeresse. Le grand prêcheur apocalytptique est de retour, et il assène plus qu’il ne chante, déversant avec morgue sur le public un flot ininterrompu d’explosions verbales et de vérités aussi définitives que lapidaires. Magnétique, halluciné, Dylan parle un langage nouveau, qui oscille entre gouaille et mysticisme, et les regards braqués sur lui sont aussi fascinés que perplexes. Aucune proximité possible avec ce gamin dédaigneux à la maturité glaçante, qui n’ érige des certitudes que pour mieux les balayer d’un trait d’esprit ou d’un revers de main. Don’t look back. Dylan trace sa route, et va semer beaucoup de monde.
Car c’est bien le trublion électrique acidifié, le bluesman yankee relooké par Carnaby Street, le dandy hirsute et mercurien que l’on croit apercevoir dans le plan final, assis sur le siège arrière d’une limousine, dissimulé derrière ses impénétrables lunettes noires et devisant sur la coolitude de l’anarchisme. En 1963, Dylan, encore toute imprégné de l’héritage de Woody Guthrie et de l’atmosphère militante du mouvement pour les droits civiques, chantait « Only a pawn in their game » à l’occasion d’un rassemblement politique dans le Mississipi. Deux ans après, la rock star absolue née sous l’objectif de Pennebaker griffonne des mots mystérieux sur des cartons qu’il laisse tomber un à un d’un air blasé sur le pavé londonien, au son d’une musique survitaminée: la sienne. Si Don’t Look Back filme une période clé de la carrière de Dylan, il rappelle également à quelle vitesse incroyable s’est opérée son évolution. Une sorte de regard en arrière sur l’accélération de l’histoire.
Vidéos :
Une des scène les plus emblématiques du film : Dylan rencontre Donovan.
La rédaction de PlanetGong se félicite d’accueillir en son sein Monsieur Denis, spécialiste de Bob Dylan, du cinéma, baron du vin rouge et chantre du football de gauche. Merci à toi !